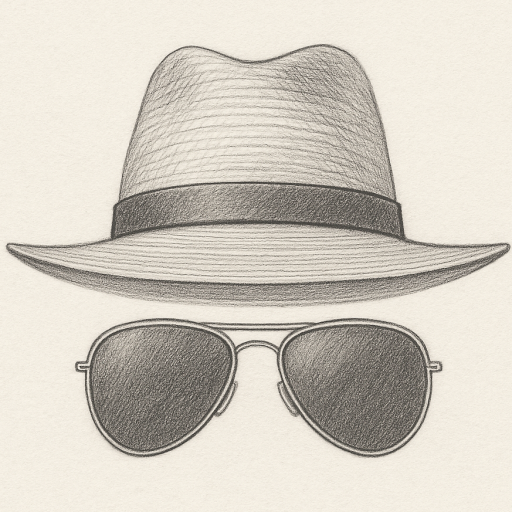Les universitaires — moi y compris — se cachent parfois derrière la complexité. Nous habillons les idées d’un langage dense, non pas toujours par orgueil, mais souvent par insécurité. La complexité rassure : elle crée une distance et donne l’illusion du contrôle. C’est vrai aussi en gouvernance. Qu’il s’agisse d’une université, d’une entreprise ou d’un hôtel de ville, on utilise parfois des mots ou des procédures complexes pour dissimuler l’incertitude — ou éviter la tâche plus exigeante d’expliquer clairement.
Mais on ne démontre pas sa compréhension en compliquant les choses, mais en les rendant claires. Mark Twain disait qu’on ne comprend vraiment une idée que lorsqu’on peut l’expliquer à sa grand-mère. J’essaie d’en faire une règle de conduite.
Mon engagement, à la fois comme enseignant et comme citoyen impliqué dans la vie publique, est de parler le même langage que les personnes à qui je m’adresse. Non pas en simplifiant à l’excès, mais en traduisant la complexité en clarté — en trouvant les mots, les exemples et les images qui rendent les idées accessibles sans en perdre la substance. Car le véritable courage, en gouvernance, consiste souvent à faire le contraire de ce qui rassure : rendre les choses compréhensibles, reliées et ouvertes à tous. Simplifier, ce n’est pas réduire : c’est clarifier.
1. La simplicité comme forme de respect
Plus j’avance dans les systèmes publics, plus je constate que la complexité peut devenir un refuge. Elle protège les décisions du regard critique et donne l’illusion de la sophistication.
Pourtant, lorsque nous prenons le temps d’expliquer clairement — pourquoi un projet coûte ce qu’il coûte, comment fonctionne un règlement, ou à quoi sert une hausse de taxes — nous créons un véritable espace de participation.
La clarté est une forme de respect. Elle dit : « Vous méritez de comprendre comment cela fonctionne. » Elle ouvre la porte au dialogue plutôt qu’à la méfiance. Dans toutes les formes de gouvernance, cette ouverture est essentielle. Lorsque les citoyens comprennent le raisonnement derrière une décision, même les choix difficiles deviennent plus acceptables, parce qu’ils se sentent inclus dans le processus.
2. Quand tout est lié
Simplifier, ce n’est pas cacher la complexité, c’est en révéler les liens. Les décisions sur l’aménagement, les infrastructures, l’éducation ou les budgets s’influencent toutes mutuellement — et façonnent notre manière de vivre ensemble. L’environnement, l’économie, la culture et le bien-être social ne sont pas des dossiers distincts, mais des fils d’un même tissu.
Lorsque ces liens sont présentés clairement — quand on montre comment la rigueur financière, la vitalité civique et le respect de l’environnement se renforcent mutuellement — la confusion cède la place à la cohérence. Voilà ce que j’entends par le courage de simplifier : la volonté de présenter l’ensemble de manière que chacun puisse suivre.
Ce n’est pas facile. La clarté exige de la discipline : ralentir, poser de meilleures questions, et résister à la tentation de se réfugier derrière le jargon technique. Mais lorsque la simplicité guide la communication, la complexité devient une invitation plutôt qu’un obstacle.
3. La simplicité crée la confiance
La confiance en gouvernance ne naît pas des slogans. Elle se construit à travers une communication claire, honnête et constante. Quand les citoyens comprennent ce qui est fait, pourquoi cela compte et comment cela s’inscrit dans des valeurs partagées, la gouvernance cesse d’apparaître comme lointaine : elle redevient partie intégrante de la vie collective.
Cela vaut partout — dans les universités, les conseils d’administration et les municipalités. Chaque explication, chaque échange peut soit renforcer la compréhension, soit l’affaiblir. Simplifier, ce n’est pas « parler à la baisse », c’est inviter tout le monde dans la même conversation.
Réflexion finale
Simplifier demande du courage, car cela met les présupposés à nu. Cela invite les dirigeants à parler simplement, à expliquer leurs décisions et à accueillir les commentaires. Mais cela construit aussi quelque chose que la complexité n’offrira jamais : une compréhension partagée.
Si je retombe parfois dans le langage académique, ce n’est pas par distance, mais par habitude. Ce qui compte, c’est l’effort pour créer des ponts — pour traduire, relier et donner du sens ensemble. Lorsque nous parlons clairement de ce qui nous unit — nos finances, notre environnement, notre culture et nos espoirs communs pour l’avenir — nous rendons la gouvernance non seulement plus ouverte, mais plus humaine.