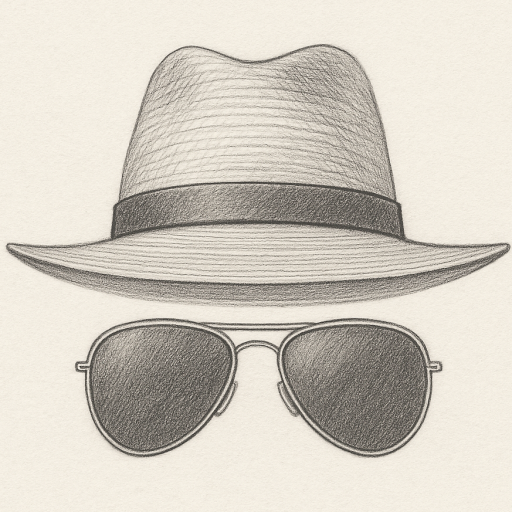Introduction
Depuis sa publication, j’ai pris le temps de lire le Référentiel de compétences du gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise. Ce cadre, destiné à aider les gestionnaires publics à naviguer dans le changement, m’a beaucoup inspiré. Ce qui m’a frappé, c’est à quel point il s’applique non seulement aux grands ministères, mais aussi à des municipalités comme la nôtre. Cette lecture m’a amené à réfléchir à ce que pourrait être une gouvernance capable d’aider un village comme North Hatley à devenir la meilleure version de lui-même.
1. De la gestion au sens
Le Référentiel m’a rappelé que la gouvernance ne se résume pas à l’efficacité ou aux procédures. Elle repose avant tout sur le sens. Le leadership, dans le service public, consiste à aligner les actions sur une intention et des valeurs communes.
J’ai été surpris de voir à quel point cela reflète notre réalité municipale. Une grande partie du travail se déroule dans le quotidien — les réparations, les permis, les budgets — mais derrière tout cela, il y a une idée plus profonde : la cohérence entre ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment cela sert les citoyens.
J’en ai retenu que gouverner, ce n’est pas détenir toutes les réponses, mais plutôt poser les bonnes questions, ensemble. Ce cadre m’a fait voir l’administration publique autrement : non pas comme une bureaucratie, mais comme un système de confiance partagé.
2. Stratégie et tactique – deux rôles essentiels
L’une des distinctions les plus éclairantes du Référentiel est celle entre les responsabilités stratégiques et tactiques. C’est une idée simple, mais qui met beaucoup de choses en perspective. Le rôle du conseil, dans sa meilleure expression, est de fixer la direction stratégique — d’articuler une vision, des priorités à long terme et les valeurs qui doivent guider les décisions. L’administration, elle, traduit cette direction en actions concrètes : gérer les équipes, répartir les ressources, prendre des décisions et assurer la prestation des services.
Cette distinction ne divise pas une municipalité, elle la renforce. Quand chacun comprend son rôle — le conseil sur le pourquoi et le où aller, l’administration sur le comment y arriver — la gouvernance devient plus cohérente, plus fluide et plus constructive.
3. Les six rôles qui soutiennent une bonne gouvernance
Le Référentiel présente six rôles que tout gestionnaire public est invité à incarner, peu importe son niveau de responsabilité.
Le premier est le porteur de sens, celui qui garde le cap sur la mission et les valeurs. Le deuxième, le propulseur de l’expérience-employé, vise à créer un milieu de travail humain, inclusif et respectueux. Le troisième, le producteur de résultats, met l’accent sur des actions mesurables et une reddition de comptes claire envers les citoyens.
Vient ensuite le pilote de changements, qui encourage l’innovation et accepte que l’expérimentation fasse partie du progrès. Le cinquième, le générateur de participation, rappelle que la gouvernance atteint son plein potentiel quand les citoyens et les partenaires sont invités à participer et à voir comment leurs contributions influencent les décisions. Enfin, le leader authentique agit avec humilité, empathie et intégrité, des qualités qui donnent leur légitimité à toutes les autres.
Ces rôles ne sont pas des titres à revendiquer, mais des pratiques à cultiver. Ce sont des manières d’agir et de réfléchir qui permettent à une communauté d’avancer ensemble.
4. Une note personnelle
Ce cadre m’a aussi touché sur un plan plus personnel. Ma famille vient du monde de l’entrepreneuriat — des gens qui bâtissent, prennent des risques et apprennent en agissant. Celle de ma conjointe, au contraire, a œuvré toute sa vie dans le service public — avec un profond respect pour la stabilité, la responsabilité et le bien commun.
Entre ces deux univers, j’ai appris à reconnaître les différentes formes que peut prendre l’engagement envers la société. L’entrepreneuriat m’a transmis le sens de l’initiative et des résultats concrets; le service public m’a appris la patience et l’équité. Dans les deux cas, il s’agit d’un acte de soin — l’un pour construire, l’autre pour préserver.
C’est cet équilibre que je retrouve dans le Référentiel : le courage d’agir et l’humilité d’écouter.
5. Ce que j’en retiens
S’inspirer de ce cadre pourrait nous aider à imaginer, à l’échelle locale, une gouvernance plus cohérente. Un conseil qui réfléchit à long terme, conscient des effets de ses décisions sur les générations futures. Une administration qui offre des services clairs, accessibles et responsables. Et une communauté qui se sent invitée à participer plutôt qu’à simplement recevoir de l’information.
Ce n’est pas une recette, mais une boussole — une manière de s’orienter vers plus de clarté, d’ouverture et de confiance partagée.
Conclusion
Le Référentiel ne propose pas un modèle parfait. Il offre mieux que cela : une aspiration. Tout comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, il nous rappelle que le progrès naît du respect, de la cohérence et d’un sens partagé de la responsabilité.
Pour moi, cette lecture a été un rappel tranquille : une bonne gouvernance n’est pas une question de contrôle, mais d’intendance. Elle ne consiste pas à avoir raison, mais à rester cohérente.
C’est ce type de leadership que je souhaite continuer d’apprendre et de pratiquer ici, un pas à la fois.