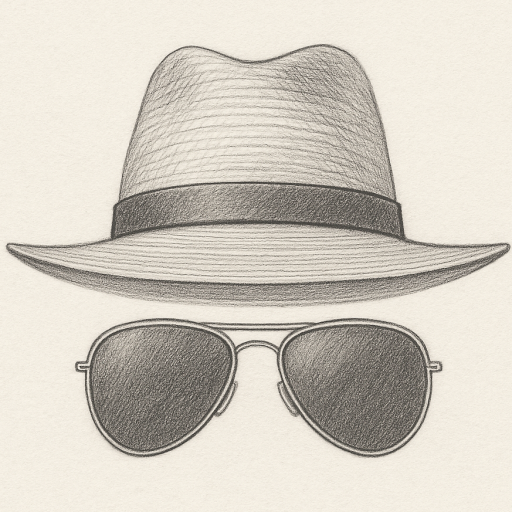Un tarif, une pub et un siècle de complaisance
Quand Donald Trump a annoncé qu’il allait hausser « le tarif sur le Canada » de 10 % « au-delà de ce qu’ils paient déjà », la réaction à Ottawa ne s’est pas fait attendre : surprise, frustration et confusion totale.
Le déclencheur ? Une publicité du gouvernement de l’Ontario qui reprenait les paroles de Ronald Reagan sur le libre-échange, diffusée pendant la Série mondiale.
Ça peut sembler absurde — une crise diplomatique à cause d’une pub — mais c’est surtout le symptôme d’un vieux réflexe canadien : dépendre d’un seul client.
Un siècle de dépendance confortable
Depuis ses débuts, le Canada a bâti sa richesse en exportant vers un grand partenaire : d’abord le Royaume-Uni, puis les États-Unis. Aujourd’hui encore, environ 74 % de nos exportations prennent la route du sud, selon Statistique Canada.
C’est logique du point de vue géographique et logistique. Mais c’est aussi risqué : chaque fois que Washington éternue, l’économie canadienne s’enrhume.
La leçon du monde des affaires
Toute entreprise sait qu’il est dangereux de dépendre d’un seul client. Si un seul contrat représente la majeure partie des revenus, le moindre changement peut tout faire basculer.
À l’échelle d’un pays, c’est encore plus compliqué : diversifier ses marchés ne se fait pas avec un coup de fil. Ça demande de renégocier des traités, de repenser les chaînes d’approvisionnement et d’adapter tout un appareil commercial.
L’efficacité sans la résilience
La spécialisation a enrichi le Canada, mais elle l’a aussi rendu vulnérable. Un système trop efficace finit par perdre sa capacité à s’adapter. Les économistes appellent ça la dépendance de sentier : plus on s’enfonce dans une voie, plus il devient difficile d’en sortir.
Notre économie fonctionne très bien tant que la demande américaine reste stable. Dès que ça bouge à Washington, tout vacille.
Le paradoxe des ressources
Le paradoxe, c’est que le Canada ne manque pas de moyens pour se diversifier : il manque de transformation.
Nous sommes parmi les plus grands producteurs mondiaux de minéraux essentiels (nickel, cuivre, lithium, potasse), de bois d’œuvre et de produits agricoles. Pourtant, la majorité quitte le pays sous forme brute.
En 2024, par exemple, près de 80 % du bois canadien exporté était du bois de sciage non transformé. Même tendance dans les métaux : le Canada extrait plus de 500 000 tonnes de cuivre par an, mais raffine à peine la moitié de ce qu’il produit.
On résume souvent la situation par une vieille blague économique : le Canada vend du bois d’œuvre aux États-Unis, et ils nous renvoient des cure-dents.
Changer le réflexe
C’est ici que la diversification prend tout son sens. Elle ne passe pas seulement par de nouveaux marchés, mais par une nouvelle logique de création de valeur :
– Transformer davantage ici, avant d’exporter.
– Intégrer les chaînes de valeur vertes et technologiques (batteries, hydrogène, matériaux de construction avancés).
– Renforcer la production régionale pour que la richesse circule au sein du pays avant de sortir des frontières.
Pendant que Trump hausse les tarifs, le vrai enjeu n’est pas de répondre au coup pour coup, mais de repenser la structure : faire du Canada non pas un fournisseur de matières premières, mais un architecte de produits finis.
Les tarifs vont et viennent. Ce qui reste, c’est la valeur qu’on choisit de créer chez nous — ou ailleurs.